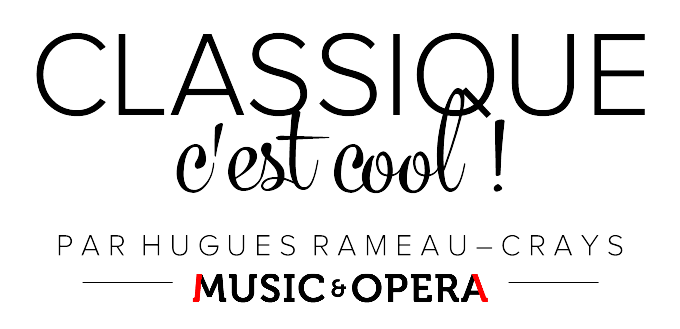À Rouen, des Carmélites succombent en chantant sous la pluie
L’Opéra de Rouen Normandie fait souvent parler de lui en bien. Des mises en scène inspirées viennent souvent servir une programmation audacieuse. Pour mettre en scène Dialogues des carmélites, il a pris le risque de choisir une nouvelle venue. Compte-rendu…
Dialogues des carmélites de Francis Poulenc est un chef-d’œuvre absolu qui, production après production, bouleverse les spectateurs de plus en plus épris. Inspiré de l’exécution des carmélites de Compiègne sous la Terreur, l’histoire de Blanche de la Force, la jeune aristocrate parisienne qui entre au Carmel jusqu’au supplice, a inspiré de nombreux metteurs en scène de talent comme Olivier Py. Un mur d’étoiles servait de décor à sa scène finale où les carmélites montent à l'échafaud en chantant un bouleversant Salve Regina. Il a plu sur le plateau de l’Opéra de Rouen Normandie, le 1er février 2025, rappelant les mots de Bernanos prononcés par Blanche au début de l’opéra : « Mon Dieu, il en est peut-être du péril comme de l’eau froide qui d’abord vous coupe le souffle et où l’on se trouve à l’aise, dès qu’on y est entré jusqu’au cou ». De mémoire de rouennais, jamais on avait vu production aussi aboutie théâtralement.
Le bûcher arrosé de Jeanne d’Arc à l’Opéra de Rouen Normandie
Ce n’est pas la première fois que les Dialogues est monté au Théâtre des Arts. C’est en revanche la première mise en scène d’opéra de Tiphaine Raffier, la jeune femme s’étant auparavant illustrée comme comédienne, auteure, metteuse en scène au théâtre et réalisatrice. Tour de force et coup de maître, sa production réaliste atteint des sommets de dramatisme. Les premières scènes chez les de La Force apportent un éclairage nouveau sur le personnage de Blanche tandis que son père et son frère découvrent les murs de sa chambre d’adulescente couverts d’images religieuses. Petit clin d’œil à la capitale de la Normandie, elle se rêve en Jeanne d’Arc dans des vidéos (signées Nicolas Morgan) intelligemment utilisées pendant le prélude musical. La caméra tournoyante qui fixera le visage des carmélites avant la guillotine trouve ici son utilité. Même si elle reste fidèle au texte, Tiphaine Raffier se permet quelques pas de côté afin de servir la psychologie de ses personnages. La première rencontre de Blanche avec Madame de Croissy, la révérende mère, ne se fera pas au parloir mais dans la chambre discrètement inspectée par le personnage revêche de Mère Marie. Les décors de plus en plus dépouillés -de l’appartement moderne, de sanitaires très réalistes, du carmel et de l’échafaud- passent du naturalisme au symbolisme, jusqu’à la pluie qui noie le plateau comme un flot de sang après l’exécution. Inspirés par différentes époques, les costumes de Caroline Tavernier participent à l’atemporalité du spectacle même si le drame historique est judicieusement rappelé par des incursions de texte et d’extraits de discours d’époque prononcés à l’Assemblée Nationale.
Dans la pleine possession de sa santé vocale, Madame de Croissy meurt affreusement
Les différents niveaux de lecture participent à la force du spectacle qui repose sur l’incroyable intensité des chanteurs-acteurs. La palme du martyre revient à la prestation hallucinante de Lucile Richardot. Madame de Croissy meurt dans des souffrances rendues avec un réalisme à la fois bouleversant et malaisant par la contralto qui maîtrise son chant à la perfection. D’une santé vocale presque insolente dans ce contexte, elle chante chaque mot apportant ici la nuance, là un forte impressionnant sans jamais user d’un parlando malvenu. La scène de la mort placée dans les sanitaires du carmel est sans doute la plus marquante grâce à l’implication des solistes et à la lecture fouillée de Tiphaine Raffier. Dans la gestuelle corporelle d’Eugénie Joneau, on comprend la rectitude mais aussi l’aigreur de Mère Marie, l’éternelle seconde qui tend un silice à la petite Blanche jalousée, devenue son souffre-douleur. La mezzo enchante par l’homogénéité de son timbre et l’intelligence de son chant. Blanche de La Force évidente, Hélène Carpentier, avec naturel et profondeur, faisait pourtant une prise de rôle. A n’en pas douter, elle retrouvera la partition qu’elle pourra approfondir comme l’a fait avant elle Patricia Petibon, son illustre devancière. Les aigus tendus d’Emy Gazeilles ne l’empêchent pas d’incarner une touchante Sœur Constance, novice cependant plus terrestre que céleste. Même si la grande et belle voix d’Axelle Fanyo n’est pas idéalement choisie pour le rôle de Madame Lidoine, l’ensemble de la distribution, entièrement française, est à saluer grâce à une diction impeccable et à une intensité dramatique. Le baryton Jean-Fernand Setti, sonore Marquis de La Force, est un Geôlier de luxe comme le ténor Matthieu Justine, très crédible en Premier Commissaire. En faisant vivre leur personnage, Aurélia Legay (Mère Jeanne), François Rougier (L’Aumônier du Carmel), Thierry Ronan Airault (Monsieur Javelinot) et Jean-Luc Ballestra (Deuxième Commissaire) sont à citer également. Vif, attentif et fiévreux, le chef d’orchestre Ben Glassberg est également un acteur majeur de la réussite du spectacle, à la tête de l’excellent Orchestre Régional de Normandie et du Chœur accentus / Opéra de Rouen Normandie. Il se montre particulièrement déchirant à l’occasion des retrouvailles de Blanche et de son frère (impeccablement incarné avec subtilité et profondeur par le superbe ténor Julien Henric). La production qui sera reprise à Nancy en janvier 2026 est assurément l’un des spectacles les plus marquants de la saison 2024-2025.